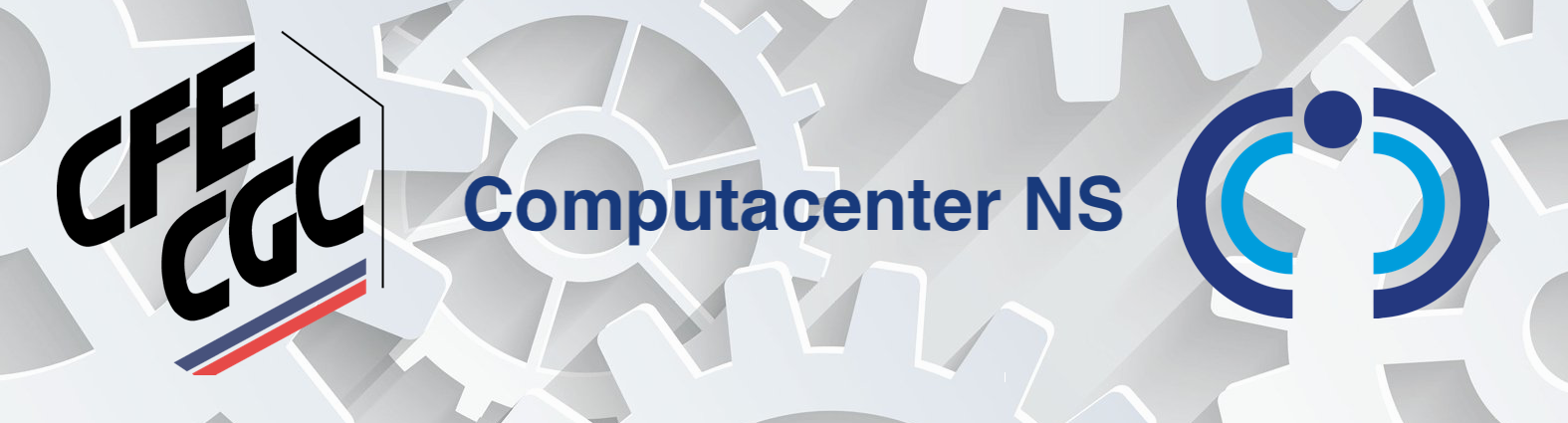Muriel Pénicaud a continué cette semaine de décliner son « programme de travail pour rénover notre modèle social » auprès des syndicats reçus au ministère du Travail. Stéphane Béal et Sylvain Niel, avocats au cabinet Fidal, décryptent les pistes annoncées.
par Emmanuel Franck et Marie-Madeleine Sève 14/06/2017 Entreprise & Carrières

Le court document (cinq pages) présenté le 6 juin par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, pose notamment les grands objectifs d’une réforme du droit du travail et un calendrier : concertations avec les partenaires sociaux jusqu’au 21 juillet puis publication des ordonnances « d’ici la fin de l’été ».
Le programme annonce une « nouvelle articulation de l’accord d’entreprise et de l’accord de branche ». Jusqu’à présent, le législateur a utilisé deux outils juridiques pour articuler ces deux niveaux de négociation : la dérogation (les accords de branches priment sur les accords d’entreprise sauf dans les domaines où les accords d’entreprise peuvent déroger) et la supplétivité (les accords d’entreprise priment sur les accords de branches, ces derniers suppléant l’absence d’un accord d’entreprise). Deux outils juridiques différents pour la même finalité : « Déplacer le curseur du côté de la branche ou du côté de l’entreprise », analyse Stéphane Béal, directeur du département droit social du cabinet Fidal.
Muriel Pénicaud a exprimé, le 6 juin, sa conviction que « la norme du travail de demain doit être co-élaborée par les partenaires sociaux, et d’abord dans l’entreprise », avant d’ajouter que « la branche doit également jouer tout son rôle dans la régulation économique et sociale sectorielle ».
La réforme à venir sera une continuation de l’existant. La loi de 2004 sur le dialogue social pose en effet déjà que les accords d’entreprise peuvent déroger aux accords de branche à deux exceptions près : les domaines que la loi réserve à la branche (minima salariaux, classifications, garanties collectives de solidarité, mutualisation des fonds de la formation professionnelle et, depuis la loi Travail : pénibilité et égalité professionnelle) et les domaines que la branche se réserve (clause de verrouillage).
« La réforme supprimera-t-elle des domaines sanctuarisés ?, s’interroge Stéphane Béal. J’en doute. Interdira-t-elle aux branches les clauses de verrouillage, et dans quels domaines ? ». L’autre outil a été utilisé notamment dans la loi Travail de 2016, qui pose que l’accord d’entreprise s’impose dans le domaine du temps de travail. La réforme consistera-t-elle à élargir les domaines de l’accord d’entreprise ?
Le document du ministère prévoit également de « mieux sécuriser les accords conclus et leurs modalités d’application et de validité ». « Une piste intéressante consisterait à faire pré-valider l’accord par l’administration afin de limiter les recours sur des détails formels, déclare Stéphane Béal. On pourrait aussi imaginer de limiter les délais de contestation d’un accord. » Mais la réforme pourrait aller au-delà, selon l’avocat : « La sécurisation des accords ne suppose-t-elle pas aussi qu’ils s’imposent sur le contrat de travail, dès lors que le contrat rend l’application d’un accord impossible ? » Le sujet est délicat : les syndicats y sont hostiles. Mais comme le rappelle l’avocat, ce principe est déjà à l’œuvre dans la loi Aubry 2, dans la loi Rebsamen (sur les questions de mobilité) et dans la loi Travail (accords de préservation de l’emploi).
La ministre du Travail prévoit en outre de fusionner les IRP « de consultation », à savoir les DP, CE et CHSCT, afin de simplifier et de renforcer le dialogue social. Stéphane Béal voit deux pistes possibles de réforme. D’abord élargir la possibilité de regrouper ces trois IRP. À l’heure actuelle c’est une décision qui peut être prise unilatéralement par la direction mais uniquement dans les entreprises employant moins de 300 salariés. Dans la continuité des lois Rebsamen et Travail, faut-il continuer de déplacer ce seuil, le supprimer, voire même considérer qu’il n’existe plus qu’une seule instance à défaut d’un autre choix ? L’autre piste consisterait à créer « une vraie IRP unique, moins compliquée que la délégation unique du personnel, qui fonctionne en fait comme trois IRP regroupées », recommande Stéphane Béal.
Le ministère veut enfin faciliter le dialogue social dans les TPE-PME. « Les lois successives ont beaucoup élargi les possibilités de négociation avec des élus ou des salariés mandatés, constate l’avocat. Mais il est vrai que les PME sont toujours réticentes au mandatement d’un salarié. » Faut-il alors leur donner la possibilité de consulter directement leurs salariés ? « Attention, prévient Stéphane Béal, un référendum n’est pas une négociation ! »
Autre mesure clé, le plafonnement des indemnités prud’homales, réclamé par le Medef et les petites entreprises. « Il n’est pas normal et pas sain qu’un même fait puisse donner lieu à des dommages et intérêts allant du simple au triple sur le territoire », déclarait Muriel Pénicaud qui a annoncé une discussion portant « non pas sur les indemnités de licenciement, qu’on ne plafonnera pas, mais sur les dommages et intérêts ». Le gouvernement entend encadrer les montants accordés par les juges pour licenciement abusif, ou sans cause « réelle ou sérieuse ».
Ce n’est pas une première, puisque la loi Macron du 6 août 2016 instaurait déjà un barème obligatoire, en fonction de l’ancienneté du salarié et de la taille de l’entreprise, mais il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, estimant que le critère de taille créait une rupture d’égalité pour un même préjudice. Repris sur le principe dans la loi Travail, ce barème devenu incitatif a été publié par le décret 2016-1581 du 23 novembre 2016 : il propose 3 mois de salaire pour 2 ans d’ancienneté, au maximum, il propose 21,5 mois pour les salariés ayant 43 ans d’ancienneté et au-delà.
Seulement la formulation « barémisation des dommages et intérêts » utilisée dans le document présenté, pose question. « En employant le pluriel, elle laisse planer le doute sur le fait de savoir si la barémisation n’inclut que le licenciement abusif ou au contraire si c’est la somme de tous les dommages que pourraient subir le salarié », analyse Sylvain Niel, avocat-conseil en droit social et associé au cabinet Fidal.
Car le risque, selon ce praticien du droit, c’est que les juges, estimant cette grille insuffisante au regard de la situation fragile des plaignants, contournent le plafond en dénichant d’autres chefs d’indemnisation qui feront gonfler les montants, tels la discrimination, le harcèlement moral, la procédure vexatoire, la perte de chance, la perte d’évolution professionnelle, le non-respect du temps de travail, etc. « Dès lors, on indemniserait non plus l’absence de motif de la rupture, mais les préjudices occasionnés par la rupture », résume-t-il. Ou alors, ce sera un barème à tiroirs, reprenant toutes les thématiques, sauf à rendre le barème incitatif déjà existant, obligatoire.
« Ce n’est pas le forfait qui me semble capital mais une réparation équitable, nuance pour sa part Joël Grangé, avocat associé chez Flichy Grangé Avocats. On doit pouvoir trouver des critères autres que la seule ancienneté pour permettre aux juges de rendre véritablement la justice, comme la durée prévisible du chômage, l’effort de recherche d’emploi, l’indemnité déjà touchée dans le cadre d’un licenciement. » Il souhaite que les conseils des Prud’hommes et les cours d’appel, se penchent autant sur l’ampleur du préjudice que sur les règles de droit et par conséquent tiennent compte souvent dans leurs décisions, des sommes déjà perçues au titre du licenciement.